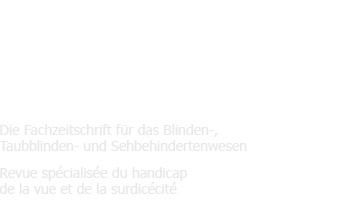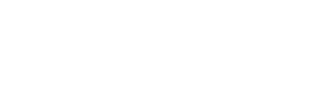Comment améliorer la collaboration entre médecins et services de consultation ?
Etude PROVIAGE

Les résultats de l’étude PROVIAGE sont là et ils révèlent des lacunes dans la pratique de transfert. Les personnes concernées par un handicap visuel lié à l’âge ne savent souvent pas qu’elles peuvent s’adresser à des services de consultation pour s’informer gratuitement sur les prestations existantes. Ou elles n’arrivent pas à se décider à s’y rendre alors que l’ophtalmologue les y a transférées.
Par Michel Bossart
En collaboration avec Retina Suisse, une association de patientes et de patients affectés de rétinite pigmentaire (RP), de dégénérescence maculaire, du syndrome d’Usher et d’autres maladies du fond de l’oeil, l’UCBA a lancé une étude en 2021. Le but était de trouver pourquoi de nombreuses personnes âgées atteintes d’une maladie oculaire renoncent à se rendre dans un service de consultation spécialisé.
Vivianne Visschers, responsable de la recherche à l’UCBA depuis 2023, s’est occupée de l’étude PROVIAGE (en toutes lettres « Professional Network for Visual Impairment in Old Age », en français : Pour un réseau professionnel en cas de déficience visuelle à un âge avancé). Concernant la genèse de ce projet, elle explique : « Sur la base de nos propres estimations et études, nous connaissons à peu près le nombre de personnes concernées en Suisse. Nous savons aussi que plus les gens vieillissent, plus ils risquent d’être atteints d’une déficience visuelle. Malheureusement, nous n’ignorons pas non plus que seule une fraction de ces personnes profite de l’offre gratuite de conseils que proposent des organisations telles que l’UCBA, Caritas, la FSA et d’autres. Il existe donc quelque part une lacune, mais où ? »
Etude scientifique
Pour la réalisation de l’étude, la collaboration de deux hautes écoles de travail social a été sollicitée. Alexander Seifert de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse a assumé la direction du projet et Romain Bertrand de la Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) a été responsable pour la Suisse romande. Dans un premier temps, tous les acteurs appelés à coopérer ont été définis avec précision et toutes les directives, résultats d’études et recommandations déjà existantes ont été rassemblés. Ensuite, des ateliers ont été organisés sous forme participative et en impliquant les représentantes et représentants des médecins de famille, des ophtalmologues, des services de consultation pour personnes atteintes d’un handicap visuel ainsi que des personnes âgées, des responsables de services à domicile et des orthoptistes afin d’examiner plus en détail le sujet. Vivianne Visschers poursuit : « La troisième étape était consacrée à l’enquête nationale auprès des spécialistes et des personnes concernées. » Le premier groupe pouvait s’exprimer sur le sujet à travers un questionnaire en ligne. Les personnes concernées, soit des personnes de plus de 70 ans atteintes d’une déficience visuelle liée à l’âge, étaient contactées par téléphone.
Déceptions et bonnes surprises
Le résultat de l’étude n’a pas surpris outre mesure le mandant : Oui, il existe bien une lacune dans la pratique de transfert. V. Visschers explique que l’étude approfondie selon des standards scientifiques est très utile. « Nous savions par exemple que seule une fraction des personnes qui ont été adressées à un service de consultation prenaient effectivement rendez-vous pour un entretien, mais que celles-ci ne représentent que 12 pour cent nous a quand même surpris, voire consternés !»
L’étude a aussi révélé que bon nombre d’ophtalmologues apprécient l’offre en conseils et la considèrent comme un complément au traitement médical de la déficience. « Pendant la consultation, les clientes et clients apprennent mentalement à gérer la déficience et à utiliser de manière ciblée les moyens auxiliaires dans la vie journalière », dit Vivianne Visschers, avant d’en revenir au résultat de l’étude : « Contrairement aux ophtalmologues, les médecins de famille n’ont guère de contacts avec les services de consultation, probablement parce qu’ils ne les connaissent pas et que les aspects psychosociaux d’une déficience visuelle ne font pas ou pas assez partie de leur formation. Elle admet que le médecin de famille est un généraliste qui doit savoir beaucoup de choses. « Il serait malgré tout bien que ces généralistes connaissent aussi notre offre et qu’ils prennent l’initiative d’adresser des patients à un service de consultation. »
En même temps, les bonnes surprises existent : « La majorité (environ 75 pour cent) des ophtalmologues connaissent l’offre des services de consultation. Et les patientes et patients qui y ont été référés et qui ont bénéficié de l’offre étaient très satisfaits des prestations de leur service de consultation. »
L’hypothèse que les lacunes de la pratique de transfert pourraient s’expliquer par l’absence d’un système de transfert formel s’est confirmée. Vivianne Visschers développe : « Il n’existe pas de système de transfert unique comme pour d’autres maladies. Chaque cabinet d’ophtalmologie a sa propre méthode et ses propres idées d’amélioration. »
Exploiter le potentiel d’amélioration
Si le problème réside donc dans une pratique de transfert lacunaire entre les médecins et les services de consultation, comment l’UCBA pense-telle y remédier ? Vivianne Visschers propose qu’ophtalmologues et services de consultation se rencontrent régulièrement, de manière formelle ou informelle, pour s’entretenir de la façon de mettre au point un processus de transfert qui satisfasse les deux côtés. » Faut-il un formulaire spécial ? Les médecins ont-ils besoin d’un retour de la part des services de consultation ?
D’ailleurs, il s’agit avant tout d’aller chercher les 88 % des patientes et patients adressés qui ne se sont jamais rendus à un centre de consultation. Vivianne Visschers souhaiterait que les ophtalmologues se sentent responsables de l’ensemble du parcours du patient. « Peut-être que quelqu’un de l’assistance médicale pourrait assurer le suivi auprès des patientes et patients et demander si le rendez-vous avec le service de consultation a eu lieu et s’ils ont pu se renseigner sur son offre. » Toutefois, Vivianne Visschers fait remarquer que les services de consultation sont déjà passablement saturés. « Il y a fort à parier que nous devrions reconsidérer le type de consultation : des voies à bas seuil pour une première consultation et des méthodes plus efficaces pour l’apprentissage de nouvelles stratégies ou moyens auxiliaires. » Dans tous les cas, il est primordial que les personnes concernées profitent au plus vite de l’offre en conseils. « Bien souvent, les personnes concernées ne viennent que lorsqu’elles n’arrivent plus à se débrouiller au quotidien et c’est dommage », estime Vivianne Visschers. En effet, plus on s’informe tôt, plus il est aisé d’accepter la déficience et aussi d’apprendre l’utilisation des moyens auxiliaires. « Celle ou celui qui commence tôt par recourir à une loupe acceptera moins difficilement par la suite un appareil de lecture. Cette aide pas à pas facilite aussi le travail des conseillères et conseillers, qui devront consacrer moins de temps aux différents entretiens. »
L’heure est maintenant à l’analyse finale des résultats et à la mise en place de mesures adéquates. Vivianne Visschers conclut : « J’ai réalisé une fois de plus à quel point les bénéficiaires eux-mêmes sont importants. Peu importe si le transfert par les cabinets médicaux vers les services de consultation fonctionne très bien, peu importe si les personnes concernées, elles, ne profitent pas de l’offre en conseils. » Vivianne Visschers, qui a une formation dans le domaine de la psychologie de la santé, relève encore un autre problème. Souvent, les personnes concernées atteintes d’une déficience visuelle liée à l’âge pensent : « Je ne suis pas handicapée, je vois juste un peu moins bien. En tout cas, je n’ai pas besoin d’aide. » Là, un travail de persuasion est clairement nécessaire. Car il n’y a pas de honte à accepter de l’aide.